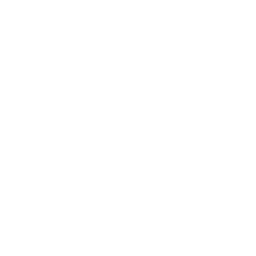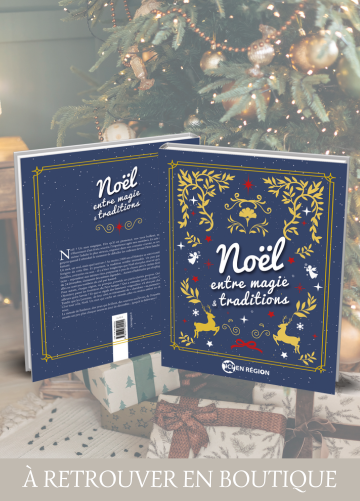Et pourtant, il est fort ancien : ses origines remontent probablement à l’an mil, comme en attestent des études réalisées sur ses murs périphériques. Le site était même occupé dès l’époque romaine. Quelques temps après, à la fin du VIe siècle, à l’emplacement de la cathédrale actuelle, il devait y avoir « l’église de l’évêque » que mentionne Grégoire de Tours. Un ensemble a bel et bien existé sous les Mérovingiens, puis les Carolingiens, mais il a été détruit au début du Xe siècle pour laisser un espace ouvert.
Depuis le haut Moyen-Âge, l’évêque était aidé par un collège de prêtres, les chanoines, tenus de vivre en communauté autour d’un cloître (celui de Chalon est donc plus ancien que la cathédrale, reconstruite vers 1090). Sa fonction était la même que dans les abbayes : permettre aux chanoines de lire et méditer dans la paix et la sérénité… et à l’abri, la galerie couverte protégeant de la pluie ou d’un soleil trop présent.
Le cloître va ensuite évoluer, en fonction du nombre de chanoines ou de leurs pratiques. Car du Xe au XIVe siècle, leurs missions vont changer ; bien que secondant toujours l’évêque dans ses tâches spirituelles, ils devront en outre entretenir et gérer financièrement la cathédrale, ainsi qu’administrer le diocèse.
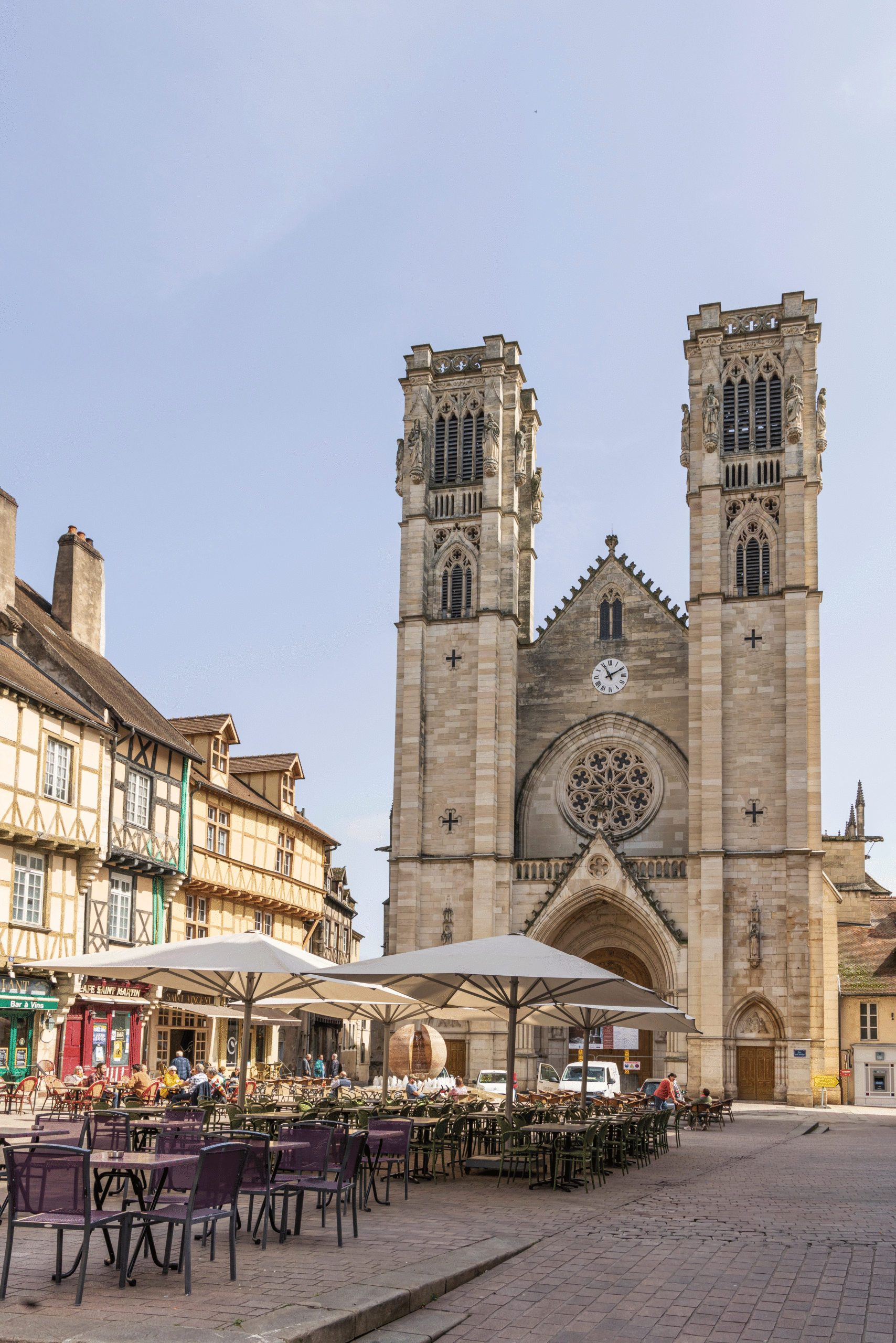
La reconstruction de la cathédrale, au XIIIe siècle, entraîne celle d’une nouvelle salle des Chapitres (lieu de réunion quotidienne des chanoines, sous la direction de leur « doyen »), en-dehors du cloître. Les chanoines s’installent alors dans des maisons individuelles autour d’une cour fermée appelée « grand cloître ». Les bâtiments qui entourent la cour du XIe siècle (« le petit cloître ») sont modifiés à partir du XIVe siècle. En 1400, une arcature trilobée à claire-voie en borde les galeries. Des décorations et autres éléments architecturaux typiques du gothique sont ajoutés, notamment, sur les galeries, les voûtes de briques sur croisées d’ogive en pierre.
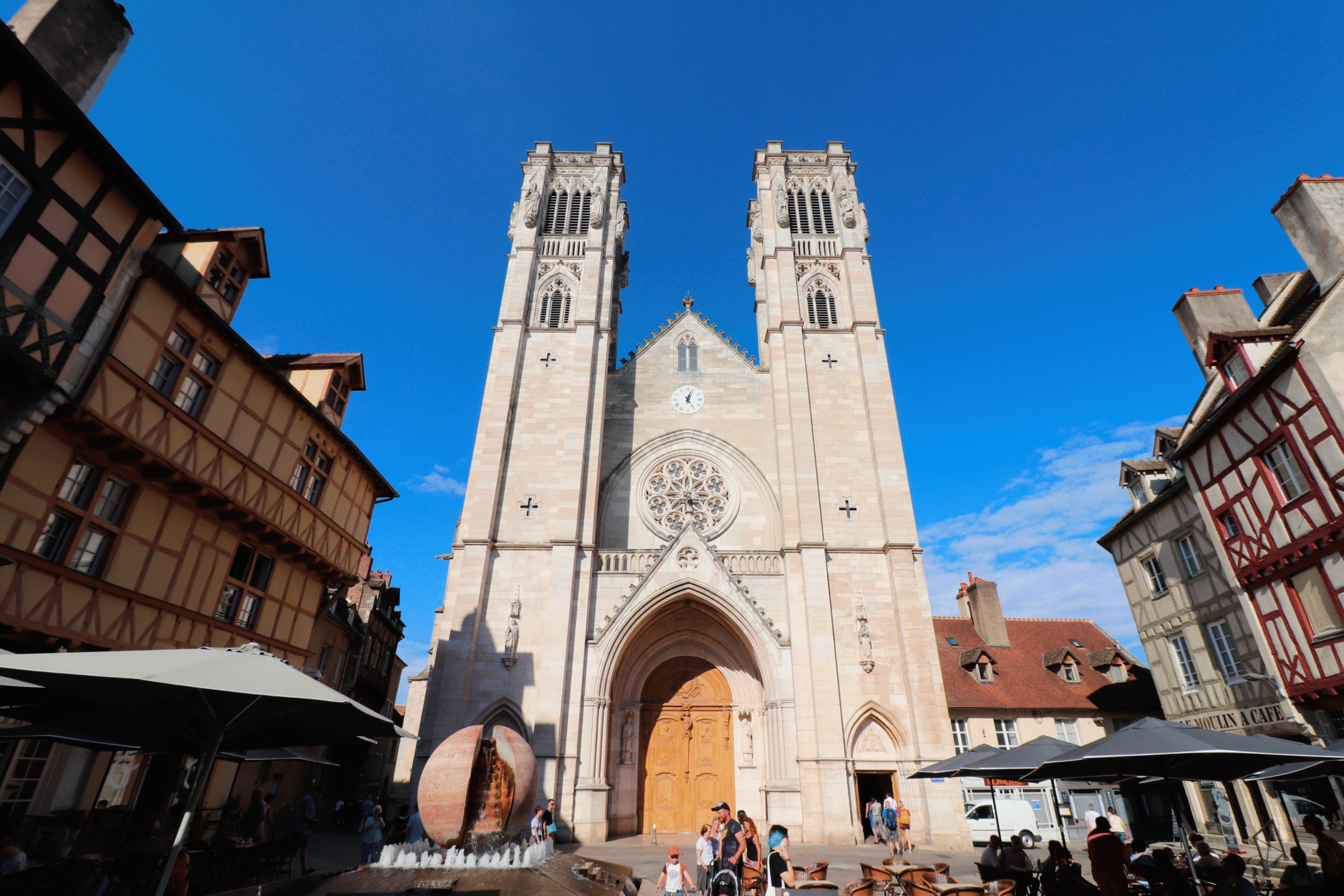
Puis, la vie canoniale suit son cours dans cet agréable décor – qui subit cependant des outrages durant les guerres de religion – jusqu’à ce qu’elle se relâche, comme partout ailleurs, et que le cloître perde son utilité. Mais sans qu’il ne soit abandonné pour autant : des travaux vont être menés au XVIIIe siècle. Vendu comme bien national en 1793, le cloître est divisé en lots et partagé entre plusieurs propriétaires. Des constructions sortent de terre dans le périmètre, tandis que ce qui demeure du cloître est destiné à être rasé pour laisser passer une rue. Ce qui subsiste sera restauré à la fin du XIXe et au début du XXe par le persévérant abbé Mugnier, vicaire et abbé de la paroisse.
Lire aussi : La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême
Classé Monument historique en 1928, le cloître devient propriété de la Ville en 1956, avant de connaître quelques améliorations permettant notamment une meilleure lecture de son emprise. Fermé au public en 2009 en raison de problèmes liés à des infiltrations d’eau, le site, objet de toutes les attentions, a été restauré en plusieurs étapes, entre 2013 et 2019, dans le plus grand respect des codes architecturaux d’époque. Mais sans refaire à l’identique ! Ainsi, la sculptrice Laetitia de Bazelaire est intervenue sur l’aile nord, entièrement détruite au XIXe siècle et récemment reconstituée, en l’agrémentant de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne).
Lire aussi : La cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême